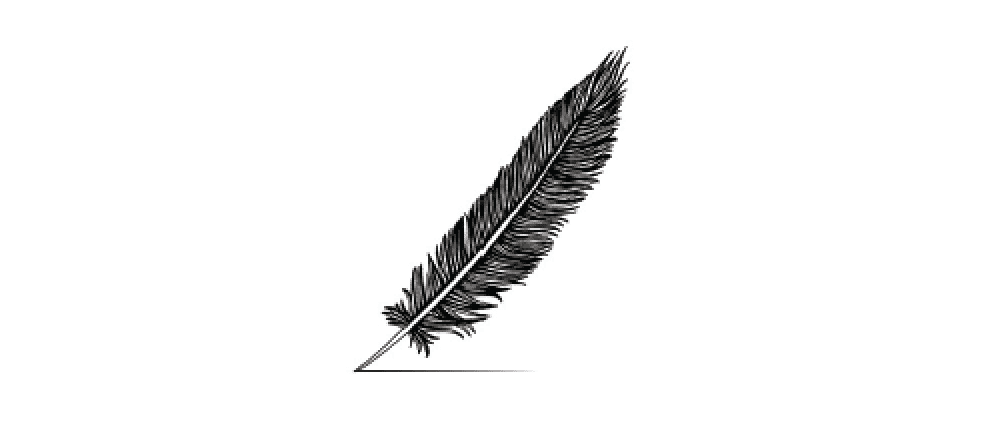
Le cigare Oblomov
Par Philippe Lançon
Quels rapports entretient le cigare avec l’action et l’inaction ? Le rêve et la veille ? La réalité et la fiction ? Le passé et l’avenir ? Soi-même et les autres ? Peut-être n’a-t-il été inventé que pour dissoudre au moins en partie, à travers le plaisir qu’il donne et le nuage qu’il répand, ces frontières et ces oppositions.
Pour sentir de quoi cette indolence et cette latence liées à la vitole sont capables, il peut être intéressant de lire Oblomov, le grand roman russe publié par Ivan Gontcharov en 1859. Il avait alors quarante-six ans et il y travaillait depuis plus de dix ans. L’écrivain était souvent paralysé comme son héros, et d’autant plus que, tel l’âne de Buridan, il hésitait entre deux textes qui se neutralisaient l’un l’autre. De même, quand le roman débute, le mélancolique barine Oblomov, qui ne quitte presque jamais son lit et sa vieille robe de chambre, fixé comme un bibelot dans la poussière de son appartement pétersbourgeois, hésite entre deux affaires qui, à raison, le préoccupent : l’état déclinant de son domaine campagnard, où il ne met plus les pieds depuis longtemps, mais à la réorganisation duquel il pense sans cesse comme à une architecture de papier, et la perspective de devoir déménager (son propriétaire veut se débarrasser de lui pour faire des travaux). Le passage à l’acte, voilà ce qui le dérange existentiellement.
Agir le sortirait du lit ou du fauteuil et de cet état flottant, intermédiaire, dans lequel il baigne avec ses souvenirs, ses idéaux, ses projets. Oblomov vit dans un temps circulaire qui lui est propre, un temps de fiction, comme Don Quichotte et comme ce personnage de Dante, Belacqua, qui vit en position fœtale au sein du purgatoire. C’est un héros de l’immobilité, un as méditatif de la procrastination. Procrastiner, comme on sait et comme les écrivains le savent mieux que personne, fait partie de l’action ; mais Oblomov pousse si loin cette fonction qu’elle a fini par liquider tout ce qu’elle pourrait déclencher. Il est comme un homme qui fumerait un cigare pour ne plus sortir de la fumée qu’il répand ; pour devenir cigare lui-même. Il y avait le roseau pensant. Oblomov est le cigare pensant.
Son père marchait sans cesse, les mains derrière le dos, d’un bout à l’autre du salon de leur demeure, en prisant du tabac et en éternuant. Il marchait comme on tourne en rond, sans rien faire, comprenant que son régisseur l’arnaque ou que les blés soient mal rentrés, mais exaspéré par ses domestiques si un mouchoir venait à lui manquer. Lui-même, Oblomov, dispose d’une tabatière et de cigares, et son âme se consume et s’évapore dans l’atmosphère confinée de sa chambre. Sa vie entière a acquis l’intériorité, la densité faite de stagnation d’un fumoir. Sur son lit, il rejoint Belacqua, Don Quichotte, Hamlet, et il leur sert un verre de kvass. Tout au fond du verre, il y a l’homme.
Il est souvent dérangé par l’odieux pique-assiette Tarantiev, qui ne vient chez les autres que pour boire, manger, prendre de l’argent, médire, râler, insulter, s’estimer maltraité, exhaler toute la mauvaise humeur du monde, tel « un grand chien de garde qui aboie contre tout le monde, qui ne laisse personne faire un pas, mais qui ne manquera pas de saisir au vol un morceau de viande, d’où qu’il vienne et où qu’il soit jeté ». Un morceau de viande, un verre de porto, dix roubles ou un cigare : « Donnez-moi du tabac ! dit Tarantiev. Mais c’est du tabac ordinaire, pas du français ? dit-il en le humant, et pourquoi ce n’est pas du tabac français ? »
Oblomov indique depuis son fauteuil une étagère et dit : « Les cigares sont là-bas, dans la petite boîte… » Le barine « demeurait […] plongé dans ses réflexions, avec ce mélange d’abandon et de grâce qui lui était propre, sans remarquer ce qui se passait autour de lui, sans écouter ce que l’on disait. Tout en les caressant, il contemplait avec affection ses petites mains blanches. » Tarantiev trouve les cigares et s’indigne : « Eh ! Mais ce sont toujours les mêmes ? » Oblomov lui répond machinalement : « Oui, les mêmes… » Car rien ne change autour de lui, tout est soumis à la rêverie perpétuelle de l’éternité campagnarde russe, du domaine lointain et toujours renouvelé, dont la seule unité de temps est la journée. Tarantiev insiste : « Et moi je t’avais dit d’en acheter d’autres, d’importation ! C’est comme ça que tu te rappelles ce qu’on te dit ! Prends bien soin d’en avoir absolument pour samedi prochain, sinon je ne viendrai plus pendant longtemps ! Dis donc, quelle saloperie ! » Et il tire sur un cigare, puis sur un autre. Bien entendu, il reviendra vite fumer les saloperies.
On peut se demander comment Oblomov peut supporter un tel personnage, et les amateurs de cigares particulièrement, qui veulent avoir la paix tandis qu’ils fument, qui fument peut-être autant pour retarder les décisions à prendre que pour éloigner les importuns. Gontcharov le sait, et nous explique à quel point l’exaspérant Tarantiev, au fond, apporte ici la vie : « Tarantiev faisait beaucoup de bruit, il sortait Oblomov de l’immobilité et de l’ennui. Il criait, discutait, bref, offrait une sorte de spectacle, délivrant ainsi le maître paresseux de la nécessité de parler et d’agir lui-même. » Le domestique d’Oblomov, Zakhar, qui le suit depuis son enfance, a entre autres la même fonction : c’est un détestable et acariâtre Sancho Panza, qui en fait le moins possible et casse à peu près tout, qui vole et insulte son maître, et qui cependant le vénère et se ferait tuer pour lui sans même y penser, car tel est son destin. La réalité dérange Oblomov, mais il ne saurait s’en passer.
Dix ans plus tôt, Gontcharov avait publié « Le songe d’Oblomov », chapitre essentiel du futur roman. Oblomov endormi (ou à moitié endormi) visite le domaine de son enfance, pièce après pièce, personne après personne. Dans son âme enchantée, le temps se suspend et se répète par les scènes de la vie quotidienne. Il pense à sa nourrice qui lui racontait de vieux contes russes. Il sait maintenant que ce ne sont que des contes, mais « le conte s’étant mêlé à sa vie, inconsciemment il déplore que le conte ne soit pas la vie et la vie un conte ». C’est le moment où il devient le cigare qu’il fume, et la fumée qui s’ensuit, et la cendre, et puis rien.
Vous devriez aimer aussi

Un VegaFina réservé à la Suisse

EXCLU Habanos S.A. absent du prochain salon Intertabac Dortmund

ALERTE Jerôme Banctel sera le chef de la Nuit de L’Amateur 2024

Les Davidoff Maduro reviennent en édition limitée

Le VF56, nouveau module dans la gamme VegaFina VF1998
Numéro en cours

L'Amateur de Cigare n° 165 (avril 2024)
Toute l'actualité du cigare directement chez vous


